Vers 1830, Louis-Guy Richelot, architecte de la Ville, utilise des terrains occupés par des maisons du XVIIIe siècle rue de Bel Air, au commencement de l'actuelle rue de Paris, pour se faire bâtir un hôtel particulier où il réside jusqu’en 1842. Après divers locataires et propriétaires, la famille de La Goublaye de Nantois qui l'acquiert en 1885 y fait d'importantes transformations qui touchent également la décoration intérieure ; l’hôtel passe ensuite par alliance à la famille Roussel de Courcy dont il a gardé le nom ; cette dernière le cède en 1950 à l’État qui y installe des services administratifs. Le Conseil régional en fait l’acquisition en 1983 et entreprend une restauration complète.
Un contexte urbain favorable
C’est dans un environnement en pleine mutation – Charles Millardet construit à cette date l'escalier monumental du jardin de la Motte aujourd’hui déplacé à l'entrée du Thabor rue de Paris – que Richelot conçoit une villa néo-classique de style palladien, adossée à la colline et entourée de jardins. Le rez-de-chaussée du corps principal, en saillie, suggère l’idée d’un socle architectural pour l’étage, en retrait, dont la loggia d'ordre ionique répond au péristyle d'entrée en dorique dépouillé. L’absence d’ordre d’architecture au troisième niveau et le large fronton concourent à l’effet monumental de la façade rythmée par la balustrade et l’entablement en parallèles continues. L'ensemble est couronné au sommet du toit par un belvédère à garde corps de fonte dont les murets latéraux escamotent la sortie des conduits de cheminées.
Un programme multiple original
Dans son état originel, l’hôtel, précédé par des dépendances disposées en hémicycle de part et d'autre d'un unique portail à colonnes doriques, devait émerger par dessus le mur sur la rue telle une imposante fabrique posée sur un socle. Cette disposition remarquable est représentée sur le cadastre de 1842 ainsi que sur des photographies de l'ancien escalier de la Motte prises vers 1880. Un bassin se trouve alors au centre du jardin et une orangerie, disparue aujourd'hui, dans l'axe de la perspective, adossée contre le mur du fond.
À l’arrière, l’escalier d’honneur et l’accès au jardin sont combinés pour racheter la déclivité du terrain ; le premier étage y devient un rez-de-chaussée surélevé, largement ouvert par un vestibule haut sur le volume simple et lumineux de la cage d’escalier qui prend naissance dans la pénombre du vestibule bas. Cet escalier est l’élément le plus remarquable de l’hôtel. La première volée, droite, flanquée de dés pour disposer des vases d'ornement, débouche sur un palier ouvrant sur le jardin puis par deux volées divergentes à quartiers tournants conduit au vestibule de l'étage. Pour rendre cette cage monumentale et lumineuse cette partie de l'escalier forme un avant-corps sur le jardin. Le mur de la façade nord est remplacé par deux colonnes créant avec les pilastres appliqués aux murs une sorte de péristyle intérieur auquel répond sur le mur du fond une élévation semblable à pilastres et fausses baies garnies de glaces. Un garde corps de fonte ornementale semblable à ceux qui subsistent entre les colonnes du péristyle du côté de la cour devait alors probablement entourer le vide de l'escalier dont les dés à l'opposé de ceux des colonnes pouvaient recevoir des vases ou des candélabres monumentaux. Les trois pièces principales situées à l'étage, prenant jour sur le faubourg de Paris et la vallée de la Vilaine,respectivement d'Est en Ouest une salle à manger, un grand salon central et un salon à l'ouest sont reliées par une double enfilade qui structure fortement l'espace intérieur et augment les effets de perspective. Le salon ouest à décor de pilastre et dont une partie est délimitée par des colonnes adopte la formule alors en vogue des pièces "à vue".
Le décor intérieur initial
Le décor intérieur voulu par Richelot, d’une sobre élégance, subsiste en grande partie. Il est composé d'ornements en plâtre armé et moulé vendus sur catalogue par la fabrique de Joseph Beunat à Strasbourg : rinceaux, rosaces et palmettes sur les tables enfoncées entre les pilastres du vestibule haut, putti ailés appliqués comme des camées sur les dessus de portes du salon central dont la corniche à modillons est rehaussées de palmettes. Dans le salon Ouest un décor plus éclectique associe des colonnes et pilastres coiffés de chapiteaux "à l'égyptienne", des frontons et une frise de style troubadour et de grands miroirs en plein cintre à bordure dorée dont la disposition en symétrie reflète la double enfilade du salon central. Au dessus de la cheminée d'origine, en marbre blanc, avec jambages à pattes de lion "à l'antique", un grand miroir cintré à parecloses et pilastres ioniques leur fait écho et achève de donner à cette pièce une ambiance tout a fait originale.
Les travaux de la fin du XIXe siècle
En 1886, Frédéric de La Goublaye de Nantois, acquéreur de l’hôtel, fait procéder à d'importants travaux. Les communs sont reconstruits pour former deux ailes rattachées au logis de part et d'autre de la cour. Celle-ci est désormais largement ouverte sur la rue par un système complexe de grilles et de piliers et un redent de son tracé permet un accès latéral direct à la cour des écuries. Au centre de la façade de l’hôtel lui-même, la loggia étage de l’hôtel est fermée par une cage de ferronnerie vitrée pour servir de jardin d'hiver en communication avec le grand salon central. Cette transformation est visible sur des vues prises vers 1966.
Lors de cette même campagne de travaux, le décor intérieur est enrichi par l’atelier Jobbé-Duval (mise en couleur de la cage d’escalier, moulures dorées, frise au sommet des murs, plafonds colorés et blasons dans les pièces d’apparat). Le plafond du vestibule reçoit une peinture allégorique "La Vérité triomphant sur le temps" due à Gaston Jobbé-Duval et datée de 1887, peinture dont le style et le thème reprennent ceux d'une peinture réalisée quelques vingt ans plus tôt par son cousin le parisien Félix-Armand Jobbé Duval pour la chancellerie du palais du Parlement de Bretagne. Les colonnes et les pilastres du vestibule sont alors recouverts de stucs à l’imitation de marbres dont le jeu de polychromie rappelle ceux réalisés quelques années auparavant à la cathédrale de Rennes et une balustrade dans le m^me esprit remplace le garde corps initial. Le sol des vestibules bas et haut est recouvert de mosaïques "à l'antique" par l’atelier Odorico.
L'hôtel de la Région
Après son acquisition par le Conseil Régional , la restauration du bâtiment, entreprise considérable et délicate, fut menée à bien entre 1984 et 1986 par la Société Armoricaine de Restauration et par l’atelier Jobbé-Duval pour la décoration ; cette demeure d’architecte a retrouvé sa place monumentale dans le tissu urbain de Rennes.
Au cours de ces travaux une large ouverture en arc est crée dans l'aile ouest des communs pour permettre un accès à une salle semi enterrée devant accueillir l'Assemblée régionale ainsi qu'au parking installé au nord de l’hôtel dans une partie des jardins. La salle des assemblées construite en 1986, œuvre de l'architecte Bertrand Tessier, est accompagnée d'une fontaine-mur d'eau et d'une sculpture conçues par l'artiste Martha Pan.
(Jean-Jacques Rioult, 2019)





















































































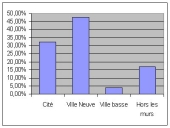


Architecte. Rennes.