La chapelle Saint-Laurent est l'une des 59 chapelles recensées sur le périmètre de Pontivy Communauté. Ce grand nombre de chapelles est en partie dû aux réalités géographiques du territoire. Les églises paroissiales, dont l’existence est connue dès le IXe siècle grâce au Cartulaire de Redon, desservent de vastes territoires. L’édification de chapelles dans les principaux villages des paroisses permettait aux chrétiens de disposer de lieu de prière de proximité. Il s’agissait alors de chapelles tréviales, dans lesquelles certains sacrements pouvaient également être rendus. Se substituant aux églises paroissiales, ces chapelles ont parfois été construites sur le modèle de l’église mère.
Situé dans l'ancien canton de Cléguérec, à l'extrémité sud de la commune de Silfiac, la chapelle Saint-Laurent est construite dans la première moitié du XVe siècle. Elle est érigée à l'initiative de la famille Fraval de Crénihuel, riche seigneur du territoire dont la seigneurie débute en 1394. L'érection de cette chapelle n'est donc pas un geste anodin. Cet acte ancre de manière pérenne la seigneurie naissante de la famille Fraval dont le manoir se situe à quelques kilomètres au nord de la chapelle.
Le village de Saint-Laurent devient vite un carrefour notoire de Silfiac. La carte de Cassini (XVIIe siècle) montre plusieurs axes traversant le lieu-dit. Le premier est le plus important. Il place le hameau sur l'axe Rostronen - Pontivy ainsi que sur la route Royale Brest - Angers. Outre cet axe majeur, il est intéressant de mentionner l’existence d'un autre chemin reliant Saint-Laurent à la ville de Guémené.
Dès le XVe siècle, la chapelle Saint-Laurent se destine à devenir un véritable point de rencontre, tout aussi important que celui du bourg de Silfiac. En témoignent les nombreuses foires qui y sont organisées depuis le Moyen-Age. Connues et reconnues par tous, elles perdurent jusqu'au milieu du XXe siècle. Les grands axes de communications passant par le village, permettent d'attirer bon nombre de commerçants. Preuve de la pérennité du succès de ces foires, le courrier des campagnes, un journal local, annonce la création de 6 nouvelles foires annuelles dans son édition du 19 novembre 1882. Au fil des années, le nombre de foires varient. La fin du XIXe siècle marque le déclin d'une époque. En 1897, une seule foire est conservée, il s'agit de celle programmée le 10 août. La tradition perdure encore aujourd'hui avec le maintien de cette foire, couplée au pardon annuel effectué en la chapelle Saint-Laurent.
L'organisation de ces foires est intrinsèque à la vie de la chapelle Saint-Laurent. Depuis la construction de la chapelle, toutes les foires prennent place au nord de l'édifice, dans un espace vide qui fait office de place publique. Les évènements les plus importants pouvaient accueillir 5 à 6 caves à cidres disséminées sous forme de tumulus.
Depuis le 15 juin 1925, le pignon sud est inscrit au titre des Monuments historiques. Le pignon date du XVIIe siècle, en témoigne la date portée de 1655.





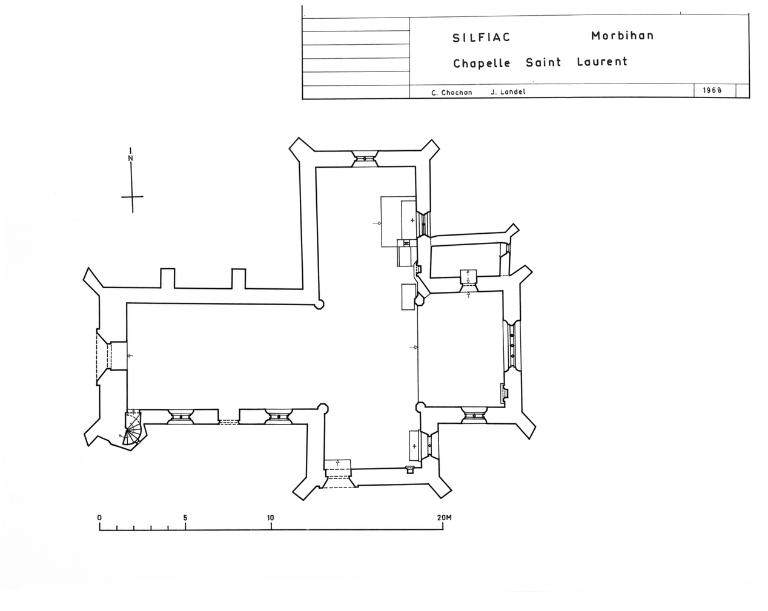




































Photographe à l'Inventaire