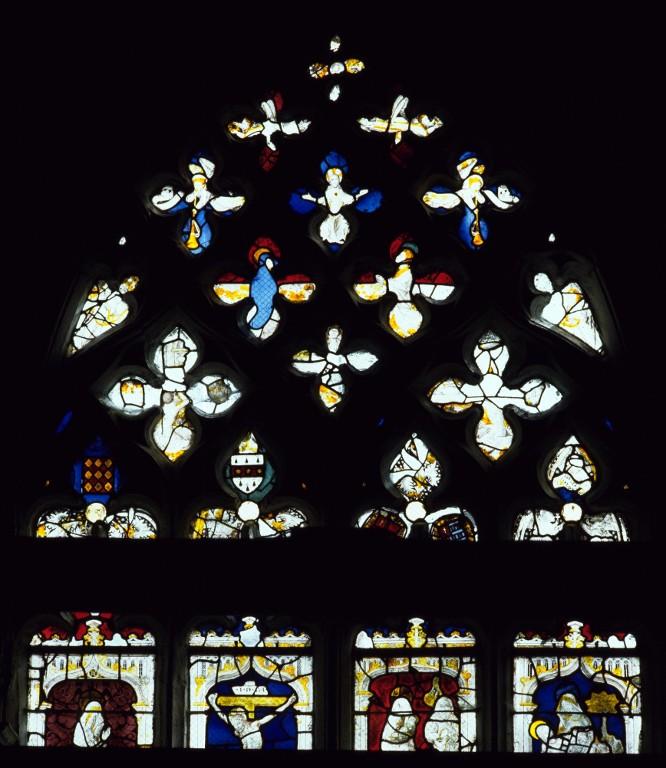La chapelle Notre-Dame de Joie de Gohazé est l'une des 59 chapelles recensées sur le périmètre de Pontivy Communauté. Ce grand nombre de chapelles est en partie dû aux réalités géographiques du territoire. Les églises paroissiales, dont l’existence est connue dès le IXe siècle grâce au Cartulaire de Redon, desservent de vastes territoires. L’édification de chapelles dans les principaux villages des paroisses permettait aux chrétiens de disposer de lieu de prière de proximité. Il s’agissait alors de chapelles tréviales, dans lesquelles certains sacrements pouvaient également être rendus. Se substituant aux églises paroissiales, ces chapelles ont parfois été construites sur le modèle de l’église mère. Elles furent alors dotées d’un placître délimité par un enclos, pourvues d’un autel extérieur et d’un calvaire. Nombre de ces monuments ont été érigés au titre de paroisse au XIXe siècle, lors de la création des communes et de la réorganisation ecclésiastique ayant marqué le siècle. Cela concerne notamment l'actuelle église paroissiale de la commune de Saint-Thuriau. De la même manière, certaines chapelles furent d’abord paroisses, avant de perdre cette affectation, tel est le cas de Notre-Dame du Gohazé en Saint-Thuriau. Dès 1160, l’existence d’une paroisse du Gohazé-Pontivy est attestée. Cette dernière fut rattachée à la paroisse de Saint-Thuriau en 1867.
La chapelle Notre-Dame de Joie du Gohazé, inscrite aux Monuments historique depuis le 8 juin 1925, est construite aux bords du Blavet au lieu dit le Gohazé. Ce village se situe à l'extrémité ouest du territoire de la commune de Saint-Thuriau. La chapelle correspond à la typologie des enclos paroissiaux bretons du XVe et du XVIe siècles et possède encore son mur d’enceinte, plusieurs échaliers ainsi que son calvaire. La chapelle du Gohazé semble n'avoir jamais été doté d'un ossuaire ou d'une porte triomphale, toutefois, des pierres tombales retrouvées dans le placître laissent penser qu'un cimetière était aménagé au sud de l'église.