CC d´EVRAN
Population 2008 : 638 hab.
Logements 2008 : 360
Bâti 1945 : 247
Hydrographie : Rivière de Rance, ruisseau de Guinefort, ruisseau de la Vallée
En 1988, la commune de Saint-Juvat a fait l’objet d’une étude de son patrimoine architectural et paysager en lien avec sa candidature au label Commune du patrimoine rural de Bretagne, et réévaluée en 2006.
La conduite de l'inventaire
La commune de Saint-Juvat a fait l´objet en 2010 d´un inventaire de son patrimoine bâti. Cette enquête menée par le service de l´Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne a pour but d´identifier, de localiser et d´évaluer le potentiel patrimonial de la commune au sein du territoire de projet, le parc régional Rance Côte d´Emeraude.
Le recensement exhaustif du bâti ancien de la commune s´est accompagné d´une étude des éléments remarquables ou représentatifs du patrimoine, choisis à partir de critères raisonnés portant sur l´authenticité, l´intérêt de l´oeuvre et la bonne conservation des abords immédiats.
Sur les 282 oeuvres recensées, 23 ont fait l´objet d´un dossier documentaire plus complet illustré par des images couleur et noir et blanc dont certaines proviennent d´une enquête antérieure réalisée en 1984 par Jean-Pierre Ducouret.
le thème des faluns
Plusieurs oeuvres et ensembles étudiés viennent alimenter des thématiques d'études transversales qui sont listées dans le dossier de présentation du projet de parc Rance Côte d'Emeraude. Le thème des faluns dont le banc géologique se trouve principalement au Quiou, Tréfumel et Saint-Juvat a été retenu comme un axe d´étude prioritaire en raison de la rareté de ce substrat géologique en Bretagne. La pierre calcaire coquillière qui en est extrait appelée également pierre de « jauge » a laissé une empreinte significative dans l´architecture rurale ancienne, maçonnerie de moellons équarris mais aussi présence de décors sculptés sur les corniches, lucarnes et souches de cheminées.
La paroisse, l´ église et la fabrique
La paroisse de Saint-Juvat est rattachée primitivement à celle de Plumaudan. Au milieu du 12e siècle, l´église est donnée au prieuré de Saint-Magloire de Léhon qui la détient jusqu´en 1767. De cette époque ne subsiste aucun vestige bien que l´on reconnaisse partiellement sa forme initiale, une nef unique terminée par un arc triomphal menant à un choeur plus bas et plus étroit, selon un modèle similaire à ceux des églises de Tréfumel et de Saint-Maden. Une première reconstruction est mentionnée par certains auteurs en 1364 sans qu´il soit possible d´en voir la trace dans l´édifice actuel. L´église est agrandie et modifiée par plusieurs campagnes de constructions qui s´échelonnent de la fin du 15e siècle au 18e siècle. Les seigneurs de la Vallée en Plumaudan y détiennent une chapelle seigneuriale au sud, tandis que le conseil de fabrique composé de notables ruraux se réunit au nord dans l´imposante sacristie à étage reconstuite en 1668. Les noms de certains des fabriciens nous sont connus par des inscriptions, Jean Caharel, sieur de la Chesnays possède à la même époque une belle maison proche du bourg au lieu dit de l'Epine et un certain Byfart dont le patronyme se retrouve gravé sur un logis de la Hautière Rousse.
Des maisons de notables ruraux
Plusieurs autres logis conservent sculptés dans la pierre le nom de leurs commanditaires et attestent de la notabilité d´un certain nombre de familles rurales proches de la noblesse locale. C´est le cas, des frères Burel, Jean et François qui reconstruisent le logis du Bois en 1671. Jean, vraisemblablement prêtre, n´a pas eu de descendance. François, marié avec Jacquemine Lesaignoux, prend pour parrain de son premier enfant George de la Motte, chevalier et seigneur de la Vallée à Plumaudan. Les logis que ces notables ruraux font construire tout en conservant une distribution propre aux maisons rurales se parent de beaux décors sculptés sur les corniches, lucarnes, et souches de cheminées à charge symbolique forte. D´autres logis, tel ceux de la Hautière Rousse et du Mottay des 17e siècle et 18e siècle présentent quant à eux une organisation et une hiérarchisation des espaces qui les apparentent à des petits manoirs. Cette richesse significative provient en partie de la production et du traitement du lin et du chanvre dont l´âge d´or se situe aux 17e et 18e siècles. Saint-Juvat dépendait de la baronnie de Bécherel reconnue à cette période pour son négoce actif en toile de chanvre et de lin « qui fait le plus beau et le meilleur fil de Bretagne ». (Ogée). Quelques logis aux allures de demeures urbaines se détachent également de l´ensemble du corpus comme le logis de la Ville es Grand Eve, proche du bourg reconstruit pour Guillaume Sevestre, avocat à Dinan et premier maire de Saint-Juvat sous la Révolution.
Quelques lieux nobles
En 1480, 4 nobles se présentent au recensement de la noblesse pour la paroisse de Saint-Juvat : Auffray de La Motte de le Vergier (le Verger), Jehanne Hamelin sans mention de lieu, Charles Le Voyer de la Cigoigne (la Sigonnière), et Olivier de la Marche de la Gouaudière (la Gaudière). Quelques vestiges épars du 15e siècle aux lieux dits du Verger et à la Mettrie témoignent de l´ancienneté de ces lieux. Le logis de la Sigonnière a été entièrement reconstruit dans la deuxième moitié du 17e siècle et les manoirs de Carragat et de la Mettrie sont des constructions plus tardives de la deuxième moitié du 18e siècle.
Evocation de quelques lieux-dits et toponymes
Parmi les anciens toponymes encore en usage, celui de la Maladrie situé au sud est du bourg rappelle l´existence au Moyen-âge d´un ancien hôpital de lépreux. Le maintien dans différentes maisons du village de plusieurs pierres sculptées d´un calice datées entre le 16e et le début du 18e siècle, emblème réservé aux prêtres, s´explique sans doute par la présence de chapelains qui auraient pratiqué dans leurs demeures une hospitalisation privée . D´autres toponymes conservent le souvenir d´ une importante activité liée au travail du lin et du chanvre : le pré du Hin (lin), sous le Douet, le Grand Douet, le pré du Rotoué, le Rotoué d´ahaut, le Rotoué du mitan, la Hautière Rousse. Le routoir, 'roussoir' ou 'rotoué' est un bassin où l´on rouit les plantes textiles, on y mettait à tremper les bottes de lin quelques jours afin d´y évacuer les gommes végétales. Plusieurs d'entre eux pouvaient se succéder pour la décantation. Cette opération donnait à l´eau une couleur rousse et une odeur nauséabonde, d´où leurs emplacements isolés mais néanmoins proches des villages à la Pommeraie et à la Hautière Rousse. Les Champs Garance, au nord, de la commune évoquent également une autre culture très ancienne celle de la Garance utilisée dans le textile pour sa belle coloration rouge. Enfin, les Effourneaux, à l´ouest du bourg, peuvent suggérer la présence d´anciens fours à chaux dont il ne reste plus aucune trace aujourd´hui.
Les anciens sites d'extraction de calcaire coquillier, dits les Perrières, Les Petites et Grandes Perrières, les Perrières Morel, se situaient principalement au sud-est de la commune entre le Porche et la Croix Chemin.















































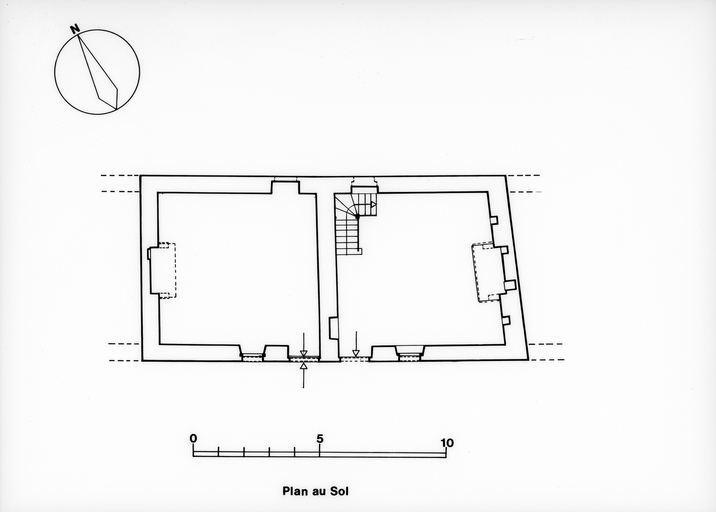













Photographe à l'Inventaire