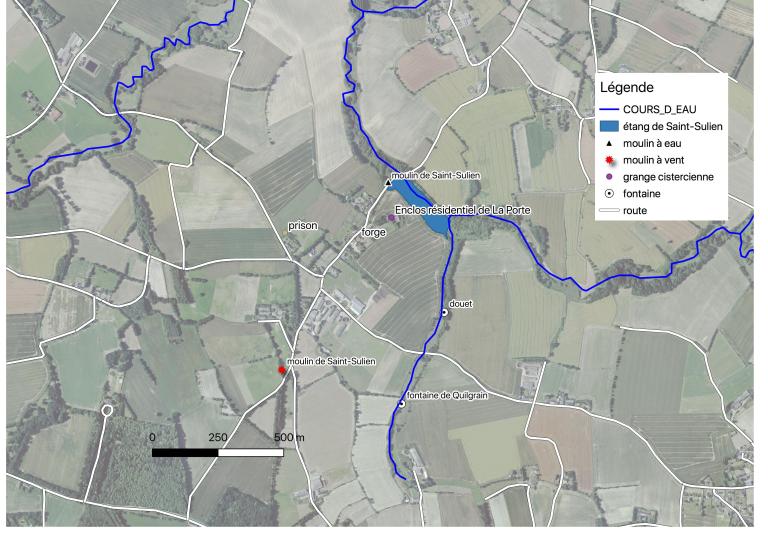L’opération d’Inventaire des granges cisterciennes bretonnes est réalisée dans le cadre d’une thèse d’histoire débutée en 2019 à l’université de Rennes 2. À l’échelle de l’ancien duché de Bretagne, on dénombre quinze abbayes cisterciennes fondées entre le 12e et le 13e siècle. Chaque abbaye possédait des domaines ruraux dont les plus importants sont nommés « granges » et les possessions rurales et urbaines étaient regroupées dans un « temporel ». Le corpus en cours comprend les granges de cinq abbayes cisterciennes : Bégard, Boquen, La Vieuville, Saint-Aubin-des-Bois et Langonnet. Chaque abbaye possédait entre six et une vingtaine de granges monastiques. Leur gestion s’étale entre le 12e et la fin du 18e siècle, époque d’aliénation et de vente des biens du clergé sous la Révolution française. De nombreux hameaux, villages et bourgs bretons ont pour origine une ancienne exploitation agricole d’origine monastique.
L’identification des vestiges laissés par les cisterciens s’est longtemps cantonnée à l’architecture des abbayes. L’intérêt pour l’économie cistercienne et les granges monastiques est d’abord le fait d’historiens puis d’archéologues sur des espaces géographiques très localisés sur le territoire français. Leur identification et leur étude restaient à faire en Bretagne et restent toujours à faire dans une grande partie de la France.
Le périmètre d’étude
Parmi les quinze abbayes cisterciennes, certaines sont inscrites au titre des Monuments historiques, d’autres appartiennent à des structures publiques ou associatives, plusieurs relèvent du domaine privé. Chaque abbaye étudiée fait l’objet d’un travail en cours d’actualisation des informations et d’un focus sur la grange domestique ou grange abbatiale. L’articulation avec les granges monastiques permet alors de percevoir l’emprise territoriale mise en place par les cisterciens au cours de leurs six siècles d’existence. La présentation générale des granges relevant d’une abbaye se veut exhaustive mais l’étude ne prendra en compte qu’un nombre réduit de sites de grange.
Méthodologie
Inventorier les granges des abbayes cisterciennes s’avère un exercice complexe. Les fonds d’archives sont très inégaux selon les abbayes et le terme de grangia n’apparaît, la plupart du temps, que d’une manière fortuite pour localiser un bien. Rares sont les inventaires à l’époque médiévale et ces derniers ne rendent compte de la situation d’un temporel qu’à une date donnée. Or ce patrimoine est en constante évolution entre le 12e et le 18e siècle. Pendant six siècles, les granges font l’objet de remaniements, découpages, déclassements dès les deux premiers siècles de leur existence. Leur étude doit donc prendre en compte d’autres modalités d’identification comme l’ancienneté, le degré d’équipements, la morphologie du domaine, la localisation géographique, la toponymie et les activités. La méthodologie retenue croise les informations issues des archives anciennes, des plans et des vestiges in situ. Le travail de recherche tend à reconstituer le patrimoine foncier et immobilier des cisterciens bretons à travers une approche historique et archéologique sur un temps long entre le 12e et le 18e siècle. L’identification des sites cisterciens met alors en lumière l’importance des ordres monastiques dans l’aménagement des paysages et l’économie rurale. Une meilleure connaissance de ces structures participe à conserver et préserver ce patrimoine rural fragile.
Enfin, le terme polysémique de « grange » doit être précisé : le thesaurus de l’Inventaire la désigne comme un édifice bâti à vocation agricole alors que le terme de « grange monastique » doit être compris comme grand domaine agricole comportant des activités agricoles et artisanales, voire industrielles dépendant d’une abbaye. Les granges monastiques d’une abbaye doivent aussi être distinguées par leur activités spécialisées (saliculture, viticulture) ou par leur localisation vis-à-vis du monastère : la « grange abbatiale » ou « grange domestique » était implantée dans le voisinage immédiat de l’abbaye et répondait aux besoins alimentaires de la communauté. Les autres granges possédaient cette même fonction tout en étant davantage tournées vers la vente d’une partie de la production.
Calendrier
La première phase d'Inventaire s'est déroulée en 2020 et a consisté à étudier cinq granges de l’abbaye de Saint-Aubin-des-Bois parmi la dizaine mise en place. La présentation de l’abbaye de Boquen a aussi été enrichie ; en 2021, ses six granges ont été étudiées. Enfin, parmi la vingtaine de granges cisterciennes relevant de l’abbaye de Bégard, onze sites ont fait l’objet de de dossiers d’études. En 2022, les interventions portent sur la présentation des abbayes de Bégard, de Langonnet et de Saint-Aubin-des-Bois. Les prochaines phases de travail visent aussi à inventorier les granges des abbayes de Langonnet et de La Vieuville.