Situation :
Ce vaste bâtiment est construit sur une parcelle traversante entre la rue de l'Esplanade et la rue Gurvand, sur un terrain en surplomb correspondant à l'ancienne butte du champ de tir. Tourné vers le Champ de Mars qu'il domine, l'édifice est précédé d'une petite cour délimitée par une grille laquelle ouvre sur la rue bordée d'arbres. A l'arrière, un vaste jardin se déploie jusqu'à un mur de clôture disposant d'entrées secondaires et sur lequel ouvre une série de garages vraisemblablement construite pendant l'entre-deux-guerres.
Description :
Composition d'ensemble et distribution :
L'édifice est composé de deux maisons jumelées disposant d'une entrée centrale commune ouvrant sur un corridor traversant. Le plan se définit à partir de cet axe nord-sud en une symétrie inversée : au corps latéral droit en saillie sur la rue (au nord-ouest) correspond une disposition analogue côté jardin, au sud-est. Les habitations sont disposées sur 3 niveaux principaux auquel s´ajoutent les niveaux d´entresol situés au-dessus de l´entrée. Celle-ci se trouve en effet disposée de plain-pied avec la rue alors que le rez-de-chaussée est surélevé d´un demi-niveau. Si les distributions intérieures originelles ont été quelque peu bouleversées, en particulier dans la maison est, le principe général est encore lisible. Le couloir d´entrée ouvrait, pour chaque partie, sur un palier servant de petit vestibule et menant, au-delà d´une volée de marche au premier niveau. La distribution s´effectue à partir de chaque palier (et demi-palier) de l´escalier droit à jour central lequel est placé à gauche du corps saillant.
Les rez-de-chaussée étaient occupés par les espaces de réception (salle à manger et salon) et la cuisine. Dans la maison ouest, la mieux conservée, un vestibule ouvre, au nord, sur une cuisine et, du côté du jardin, sur la salle à manger et le salon disposés en enfilade. Les étages sont occupés par une série de chambres et leurs sanitaires. Les pièces situées en entresol au-dessus du couloir central étaient rattachées à la maison est mais communiquaient également avec l´autre habitation. Certaines interrogations subsistent quant à la distribution du rez-de-chaussée est : il est en effet probable que l´entrée latérale gauche ait été une entrée de service.
Elévation :
Construite en moellons de schiste de Pont-Réan régulièrement taillés et couverte d'ardoises, la façade du bâtiment se signale par sa masse imposante et fortement silhouettée au niveau des toits. Les surfaces de moellons sont animées de rehauts polychromes : la brique rouge est utilisée en alternance pour les chaînages d'angles, les piédroits des baies, les bandeaux décoratifs ou encore les hautes souches de cheminées appareillées avec soin ; le calcaire en pierre de taille est réservé, dans une logique constructive, aux linteaux, appuis et consoles, ou encore comme support d'un% ornementation sculptée. Il marque, aux différents niveaux, les lignes horizontales de l'édifice. Les linteaux aux portées les plus longues sont métalliques.
Comme à son habitude, Jobbé-Duval compose ses façades sur l'équilibre des masses et de l'ornementation. Le décor, essentiellement basé sur l'utilisation des matériaux, est d'une grande sobriété ; il se concentre dans les parties hautes et sur l'entrée principale. L'avant-corps latéral gauche, en légère saillie, présente un pignon découvert orné d'une série de redents briques et pierre surmontés de bilboquets, le couronnement supérieur prenant la forme d'un édicule aux formes tourmentées. Sur la droite, lui répond une lucarne couverte inscrite au niveau du comble de l'aile en retour, également marquée par des bilboquets de tuffeau. Au centre, l'élément fort représenté par une entrée précédée d'un porche hors-oeuvre à demi croupe est contrebalancé par la tourelle saillante de l'escalier couverte en dôme. La façade sur jardin est composée sur les mêmes principes ; orientée au sud, elle est très largement ouverte par de grandes baies rectangulaires.
Construites en 1900, les maisons Berthelot se signalent par une attitude constructive profondément rationaliste et par la grande sobriété du décor, lequel avait été jusque là, dans les constructions de Jobbé-Duval, particulièrement raffiné et abondant. Doit-on y voir la réponse à une demande des commanditaires, l'influence du milieu architectural rennais (pourquoi pas celle d'Emmanuel Le Ray, son beau-frère). Quoiqu'il en soit, Jobbé-Duval affirme ici une grande force d'écriture qui l'affilie aux courants contemporains hollandais et anglais, dont les figures fortes, Berlage, Norman Shaw par exemple, ont peut-être guidé l'architecte.
Intérieur :
L´intérieur du bâtiment recèle encore quelques éléments de son décor originel. Le corridor central desservant les entrées particulières et le jardin est couvert d´un plafond à solives métalliques orné d´une série de panneaux rectangulaires jaunes se découpant sur un fond de briques vertes. Les murs latéraux, appareillés en briques orangées, présentent à mi-hauteur un entablement de calcaire mouluré surmonté dans la partie supérieure de panneaux peints également en jaune et vert. De part et d´autre des entrées, se font face une porte et une fausse porte marquée par une arcature clavée inscrite dans une travée. L´ensemble paraît être influencé par les décors bellifontains de la Renaissance où Jobbé-Duval a souvent cherché son inspiration.
A l´intérieur des habitations, sont conservés les éléments principaux du décor : lambris de mi-hauteur, cheminées, encadrement de portes, escaliers. La pièce la plus remarquable reste la salle à manger de la maison ouest avec une cheminée monumentale architecturée dont le manteau était orné d´une toile peinte disparue et un ensemble de lambris de chêne.
Conclusion :
Rompant avec la richesse ornementale qui caractérisait sa production antérieure, Frédéric Jobbé-Duval réalise ici une oeuvre de transition où l´éclectisme savant a cédé place à un rationalisme pittoresque fondé sur l´emploi raisonné des matériaux. Si ce bâtiment peut marquer de manière symbolique l´entrée de l´architecte dans le 20e siècle, l´affirmation générale de la modernité de la façade, renforcée par l´emploi de matériaux nouveaux (le fer), pourrait répondre à la volonté des commanditaires. Réalisées pour des industriels, ces deux maisons jumelées n´affichent, en dehors de leur forte silhouette, aucun des archétypes de la demeure bourgeoise mais établissent un dialogue avec le bâtiment de l´usine située juste derrière et, par delà avec l´architecture ouvrière. Symbolisme patronal et paternaliste issu de la culture industrielle, influence du milieu architectural rennais ou des grandes figures de l´architecture contemporaine en Europe, le choix de ce parti ne semble en tous les cas pas anodin. L´oeuvre, parfaitement maîtrisée, n´en est que plus intéressante.







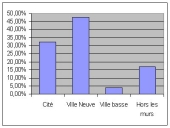

Photographe à l'Inventaire