Les recherches archivistiques nous permettent de connaître
l’église avant l’effondrement de la tour-clocher qui provoque sa ruine ainsi
que les travaux qui suivent pour sa reconstruction :
- 15 novembre 1698 mémoire des matériaux fournis pour les réparations des
couvertures de l’église (ardoises, clous, chaux, cheville) par Jan.
- 22 avril 1699 quittance de Gilles Plaudrain pour tous frais du caderans
solaire fait contre le pignon de la croisée de l’église du costé de la
grande rue (10 livres
13 sols).
- 1700 réparations de la charpente : mémoire du bois qu’il reste à acheter pour
la charpente de Saint-Patern par Jean Glas qui obtient le marché. Ces
travaux de réparations peuvent correspondre à la charpente de la nef qui
est dite dans le procès-verbal de visite de 1727 de très mauvais
assemblage sans liaison [et] qui contribue encore à pousser les murailles
qui sont vieilles et caduques en dehors ».
- 30 juillet 1701 payé à Le Ray (l’architecte ?) la somme de 60 livres à valoir
au marché de la massonne pour le rallongement de l’église de Saint-Patern.
Ce rallongement de l’édifice est cité dans le procès-verbal de visite de
1727 qui constate l’état de ruine de l’édifice : Et ayant visité un bout
de ralongement qui a esté fait à la teste de l’église depuis quelques années
[…]. D’après l’abbé Luco qui reproduit ce document dans son article, il
s’agit du prolongement du chœur et de la sacristie réalisés d’ailleurs
très sommairement d’après ce procès-verbal car les enquêteurs constatent
la faiblesse des longères pour soutenir l’écartement de la charpente […]
[entraînant] l’ouverture qui s’est faite dans l’arcade qui est dans le mur
de refente […] de manière que ce bout d’église ne peut rester debout
lorsqu’on défera le pignon qui est entre la vieille église et le neuf. A l’issue
de leur visite, les enquêteurs soulignent la nécessité de démolir ce
bâtiment neuf pour profiter des matériaux et aider à réédifier l’église
qu’on a dessein de bâtir à neuf.
- 30 septembre 1701 Jean Martin fait deux estrieux de fer pour lier la charpente
avec la vieille. Il est question en effet dans le procès verbal de visite
de 1727 d’un tirant chevillé sur les sablières pour empescher la poussée
de la charpente et l’écartement des dits murs […].16
août 1702-1er mai 1703 mémoire des matériaux fournis par René Le Barbier
pour le bâtiment neuf de l’église de Saint-Patern (ardoises, clous,
lattes) pour 271 livres 8 sols 3 deniers. Ce bâtiment neuf
correspond au prolongement du chœur et de la sacristie située en façade
nord puisque l’on suppose l’existence d’une maîtresse-vitre au-dessus du
grand autel. En effet, il est signalé en 1698-1699 un raccomodage du
treilly du vitraille du grand autel pour seulement 4 livres 11 deniers.Janvier
1703 mémoire des matériaux fournis pour réparer la couverture de l’église
de Saint-Patern.
- 15 décembre 1703 payé 16 livres 10 sols pour six barreaux de la fenestre de
la sacristie.
- 11 mai 1704 payé 90 livres à Yves Le Ray architecte pour des
augmentations par luy faites dans le bastiment du chœur et grand autel par
délibération du 11 mai 1704.
Ruine de l’église :
- 1721 effondrement de 15 pieds de la tour-clocher de l’église du à une
grosse tempête.
- 17 septembre 1724 décision d’abattre et de relever cette tour mais cette
décision n’est pas exécutée assez rapidement.
- 9 mai 1726 effondrement total de la tour-clocher de l’église ruinant
l’édifice et ses chapelles.
Les travaux de reconstruction :
- 20 avril 1727 différends sur la reconstruction : les paroissiens ne sont pas
d’accord de commencer celle-ci par le chœur et la croisée pour 2 raisons
dont la seconde est l’espace trop grand selon eux existant dans le projet
de l’architecte Olivier Delourme entre l’édifice neuf et le bout de
l’ancienne nef qui doit rester debout jusqu’à ce que le général aie trouvé
les fonds pour le réédifier ; afin d’éviter le retardement, les
paroissiens préfèrent d’abord bastir la croisée et la partie de la nef
depuis la dite croisée jusqu’à l’ancien ouvrage resté debout à savoir les
murailles, charpente et couverture, enduit, crépissage et blanchissage des
murailles, serrures et vitrages. Les arcades nécessaires dans la longueur
de la dite nef pour les chapelles et tour se feront dans la suite ainsi
que le lambris et le pavé lorsque le Général aura des fonds.
- 30 avril 1727 procès-verbal d’une visite constatant l’état de ruine de
l’ancienne église après la chute de la tour.
- 1727 sur les conseils de l’architecte Olivier Delourme utilisation des anciens matériaux de
l’église pour la reconstruction.
- 19 septembre 1728 sur l’avis de Delourme nécessité d’allonger les bas-côtés
encore d’une chapelle pour qu’il s’en trouve trois de chaque côté au lieu
de 2 qui sont commencées. Deux raisons sont données. La première concerne
les derniers piliers actuellement bâtis qui ne sont pas assez forts pour résister
à la poussée des arcades. Ce qui a entraîné la pose de pieux de bois entre
les piliers neufs et les vieilles longères restant debouts pour servir
d’arc-boutants et contreforts à la poussée des voûtes. La seconde tient à
l’utilisation impossible de l’édifice commencé sans le fermer pour les
besoins du culte ce qui obligeroit de continuer la vieille charpente et
couverture pour joindre l’église neuve afin de pouvoir se servir de la
neuve église et de ce qui reste de l’ancienne pour faire cet ouvrage. Il
en coûteroit beaucoup plus qui se trouveroit d’argent perdu dans la suite
estant obligé de le deffaire et démolir dans la suite pour recontinuer le
restant de l’église ce qui n’arrivera pas en faisant et ajoutant à ce qui
est fait une chapelle de chaque costé parce que le dernier pilier du côté
du nord faisant un des piliers de la tour qui se doit faire dans la suite
se trouvant plus fort que les autres n’aura pas besoin d’arc-boutant que
de le joindre seulement par la massone avec la vieille et celuy de l’autre
côté se trouvera aussy fortifié par le jambage de la porte du porche et
qui se fera avec le pillier et par le moyen l’église neuve joindra ce qui
reste de la vieille église et l’on mettera en état de servir comme la nef
quelque temps en faisant une cloaison ? et d’ardoises pour clore la
hauteur de ce que l’église neuve passe au-dessus de la vieille et faisant
l’ouvrage de cette manière elle sera utile et sans estre obligé de rien
démolir et refaire dans la suite lorsque la paroisse sera en état de
continuer de rebâtir le restant de la dite église ». On demande dans ce
sens à Delourme de faire « un devis et une estimation de tous les bois
nécessaires pour la charpente de la dite église et couverture tant
chevrons qu’ardoises et cloux et lattes et oeuvre de main de la dite
charpente et couverture et même de la ferrure nécessaire pour les vitraux
et des vitres et du revissage et chaux de sable sur les murs par dehors et
enduit aussy de chaux et sable par dedans et blanchis et du lambris de la
ditte église et des portes avec leurs serrures et ferrure ? et d’oster les
ouvrages qui seront de trop dans la dite partie commencée avec les 2
chapelles en estat de servir avec la table d’autel simplement et le marche
pied.
- 19 septembre 1728 à la même date est prise la décision de construire une
sacristie et on prie le sieur Delourme de joindre aux devis ci-dessus
mentionnés cette dépense.
- 1729 décès de l’architecte Olivier Delourme.
- Entre le 27 mai 1736 et le 15 juin 1737 taille et pose de la pierre de taille
des balustres du chœur et des 2 autels de la croisée ; tailler et poser
les quarreaux du sanctuaire.
- Entre le 27 mai 1736 et le 15 juin 1737 payé à Blévenec 52 livres et 10 sols
et autres charpentiers de cadet pour avoir monté et descendu les echafaux
pour placer les lambris.
- Entre le 27 mai 1736 et le 15 juin 1737 demande de décharge de la paroisse
Saint-Patern dans les comptes d’une somme de 18 livres pour une
année de loyer d’une boutique qui a servi ci-devant de sacristie.
- 27 mai 1736 marché avec Jean Aillo maître-menuisier de cette ville et Pierre
Tubout son beau-frère pour l’exécution des lambris du chœur et croisée de
l’église neuve - procompte du lambris de l’église neuve de Saint-Patern. 371 livres et 5
sols pour la façon de 135 toises et six pieds du lambris suivant le marché en date du 27 may 1736.
- 30 mai 1736 le fabrique reconnaît avoir reçu de Pesnelle de Vannes 100
planches de Hollande pour les lambris au prix de 125 livres.
- 27 aôut 1736 marché passé avec Jean Lescornet maître-sculpteur à Vannes pour
le maître-autel de l’église neuve suivant ses dessins. Ce maître-autel est
remplacé dans le courant du 19e siècle, vers 1861.
- 13 septembre 1736 Pierre Guillaume reconnaît avoir reçu la somme de 148 livres pour le
blanchissage et le huilage du lambris de l’église contenant 135 toises –
et la somme de 12 livres 12 sols pour le blanchissage des pierres de
taille des vitraux et des piliers de l’église avec le bas de l’ancienne
église- et 1 livre 16 sols pour le huilage des 2 portes de la croisée.
- 24 octobre 1736 mesurage et toisage de la superficie concave du lambris de
l’église Saint-Patern (confère la transcription du document).
- 29 octobre 1736 marché passé avec Jean Vincent Chenay pour tout le vitrage de
l’église neuve de Saint-Patern consistant dans les quatre grands vitraux
du chœur, quatre pareils vitraux de la croisée de la même église et six
autres vitraux des bas-cotés des chapelles […]. 300 livres pour le
verre fourni.
- Du 8 septembre 1736 au 28 avril 1737 sciage des bois pour les parquets et
autres œuvres de menuiserie.
- Du 27 mai 1736 au 15 juin 1737 payé à Pierre Tubout maître-menuisier et 4
compagnons pour 2 portes de la croisée, tembours, cloisons et armoires de
la sacristie, garnir le tour du chœur de planches reblanchies, bancs et
chaises du chœur, poser les confessionnaux et raccomoder les vieux et
autres ouvrages les plus pressants.
- Du 27 mai 1736 au 15 juin 1737 payé à Housset plombeur 164 livres 3 sols 3
deniers pour solde de fourniture et façon de la garniture du dôme en plomb
et étaux de l’église.
- Du 27 mai 1736 au 15 juin 1737 payé à Penelle 100 livres pour 100
planches de chataîgniers pour le parquet.
- 5 décembre 1736 marché passé avec Claude Housset maître-menuisier pour faire
un parquet neuf dans le chœur de l’église neuve de Saint-Patern et de
couvrir en parquet dans le même goût le marche-pied et les marches du
grand-autel.
- Du 27 mai 1736 au 15 juin 1737 payé à Hardy 28 livres 12 sols
une centaine de tuffau en 24 pièces pour le grand autel avec Hardy de
Nantes.
- Du 27 mai 1736 au 15 juin 1737 payé à Lotember sculpteur pour la façon d’un
dessin d’autel. On sait que ce sculpteur a aussi travaillé pour la
cathédrale Saint-Pierre.
La construction de la tour :
- 1755 début de la construction de la tour clocher. Cette date a été trouvée dans
un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la ville
de Vannes datant du 14 février 1826 (confère la transcription de ce
document).
- De 1769 à 1777 compte-rendu fait par Gérard Danet au Général de la paroisse
Saint-Patern de Vannes des dépenses faites pour la bâtisse de la dite
paroisse dont il est chargé. Dans ce compte-rendu, il est signalé le 26
septembre 1769 14 livres pour des pierres tirées à Arradon sur billet
de M. Ulliac ; le 5 juin 1770 et le 15 août 1770 200 livres
à M. Ulliac architecte pour à valoir de ce qui lui est du pour la conduite
de l’ouvrage. La question se pose de savoir si Ulliac conduit cet ouvrage
suivant ses plans ou ceux de Olivier Delourme.
- 16 juin 1770 11 chartées de pierre de Tréalvé 2 livres 4 sols.
- 5 août 1771 10 livres au serrurier pour les 2 portes de la tour.
- 10 août 1771 3 livres pour passage en couleur des 2 portes de la tour.
- 8 septembre 1771 18 livres pour des pierres achetées sur le port. On
retrouve à de nombreuses reprises cette mention.
- Entre le 10 juin 1770 et 26 mai 1771 payé à Quemard pintier la somme de 10 livres 2 sols
pour la réparation du dôme de la croisée du transept.
- Entre le 14 janvier 1772 et le 6 juin 1773 il est signalé dans les comptes que
l’on réserve la somme de 817livres 8 sols à être employée aux travaux de
la tour et dont le comptable s’est chargé au compte des dix travaux.
- 25 février 1772 196 livres 4 sols pour 109 planches de sapin suivant billet de Mr Ulliac à Conan.
- 21 août 1773 153 livres 3 sols 3 deniers pour façon de 2800 pieds de lambris à 17 charrois à 3
livres 10 sols.
- 21 août 1773 43 livres 11 sols 6 deniers pour les charrois du gros bois pour faire la porte.
- 8 mars 1775 72 livres payé à Quinvis pour façon de la grande porte.
- 1775 le comptable demande la décharge de 42002 livres 3
sols et 2 deniers justifiés, consommées et employées aux frais de la
bâtisse de la tour.
- 1775 d’après Luco rallongement du bas de la vieille nef de 2 travées avant la
construction de la tour clocher. Le nombre de vitraux indiqués pour la nef
dans le marché passé avec Jean Vincent Chenay en 1736, c’est à dire 6 (3
de chaque côté) indiquent le nombre de travées rajoutées : soit 2 de
chaque côté. Ne pas oublier que Olivier Delourme avait fait rajouter une
travée en cours de réalisation de la nef (confère la transcription du
texte). Ce qui correspond aux traces de reprises existantes aujourd’hui
sur les façades latérales.30
juillet 1777 payé 12
livres 12 sols à Jean-Pierre Renaud pour avoir
garni et blanchi une des chapelles neuves. Ce qui correspond au
rallongement mentionné par Luco.
- 3 septembre 1777 compte à Guinois pour façon du lambris de la nef 60 livres.
- 5 septembre 1777 au même pour le lambris d’une chapelle.
- 28 septembre 1777 22 livres pour blanchissage et crépissage d’une
chapelle.
- 1780-178 le recteur Le Croisier a payé conformément à la délibération du 21
septembre 1779 le montant des services dus pour feu sieur Croisier, son
père la somme de 327 livres 8 sols en employ de pareille somme à la
construction de la tour suivant les billets de monsieur Bocherel (sacriste
de Saint-Patern). Le procès mentionné ci-dessous concerne aussi cette
affaire.
- 1784 procès entre le sieur Le Croisier, recteur de Saint-Patern et le Général
de la paroisse au sujet des quêtes effectuées pour la construction de la
tour-clocher et l’utilisation des fonds collectés. Ce document imprimé du
procès indique la construction de la tour jusqu’au second étage et
l’existence d’une superbe galerie correspondant au grand escalier d’accès
à l’édifice depuis la rue de La Fontaine.
- 1809 le plan cadastral de 1809 indique les fondations de la tour.
- 23 mai 1825 projet d’achèvement de la tour par Brunet-Debaines.
- 1826 secours de 7000 francs voté par le conseil municipal de la ville pour
finir la tour clocher. Trace d’un courrier concernant l’octroi d’une aide
de 1000frs, en 1826 pour achever le clocher commencé.
- Entre 1834 et 1843 les budgets prévisionnels de la fabrique annoncent plusieurs
fois la peinture du lambris de l’église pour 2000frs.
- 1841 et 1844 le plan d’alignement de 1841 indique l’achèvement de la
tour-clocher. Le plan cadastral de 1844 indique des porches d’entrée
hors-oeuvre greffés aux angles où se rejoignent le transept et le chœur.
- 1861 dans les comptes de fabrique, le maître-autel est en cours d’exécution
ainsi que le carrelage du chœur.
- 28 avril 1878 mémoire des travaux de décoration à exécuter pour le chœur par
Charpentier, peintre décorateur. Suivent en mai de la même année, ceux de
la nef et du transept par Charpentier également.
- 1879-1882 réparations sur les toitures du chœur et de la nef. Dans les comptes de
fabrique, il est noté que la toiture de l’église demandoit des réparations
urgentes en vertu d’une délibération du 6 juillet 1879. On décida de
commencer immédiatement les travaux en y employant tous les fonds
disponibles. Mais les dépenses ont été beaucoup plus considérables qu’on
ne l’avait prévu. Elles atteignent le chiffre de 7449, 51frs. Cette somme
sera payée sur plusieurs années. Il existe à ce sujet deux plans de
toiture : un dressé par Mathurin Fraboulet (de Nantes) daté du 15 juillet
1882 et un autre plan du 15 février 1883 signé par l’architecte voyer de
l’époque (signature illisible).
- 19 août 1903 travaux de grosses réparations sur la toiture du transept et du
chœur, et la charpente du transept. Travaux faits par Julien Richard pour
3010, 88frs.
- 1905 réparations du plafond des voûtes du transept de l’église suite à la chute
d’un bloc de plâtre qui s’est détaché des arcs diagonaux du transept de
l’église. Les sondages indiquent à cette époque l’existence d’un enduit en
plâtre posé sur un voligeage en bois pourri à certains endroits et à
changer sur environ 108m², des risques de chutes des moulures en plâtre
formant les arcs diagonaux et la réfection de la rosace formant la clef de
voûte. Il est prévu dans le devis estimatif un enduit à deux couches en
plâtre sur lattis neuf, compris la démolition de l’ancien enduit et
lattis.
- 25 juillet 1907 projet de reconstruction et reconstructions effectuées des 2
porches par l’architecte G. Muiron. La demande est faite par la fabrique.
Ces deux porches seront ensuite repris et transformés par l’architecte
Caubert de Cléry dans ses projets d’annexes. Ils sont ce qui existent
aujourd’hui.Août
- 1922 projet d’annexes de la partie nord du chœur de l’église par l’architecte
Caubert de Cléry.
- 5 juillet 1923 agrandissement de la partie sud du chœur par Caubert de
Cléry.






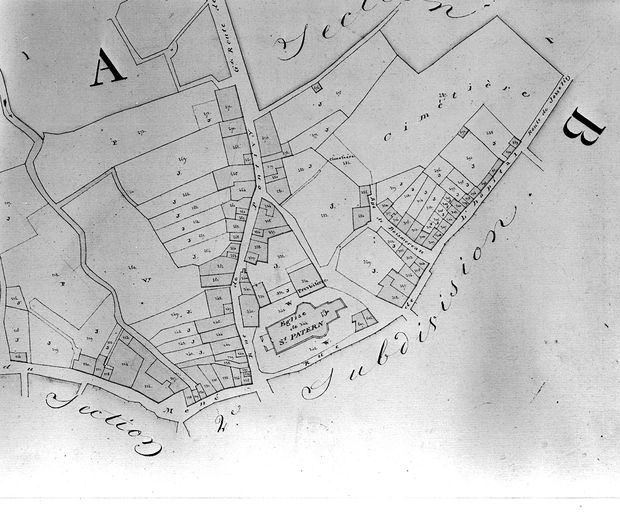
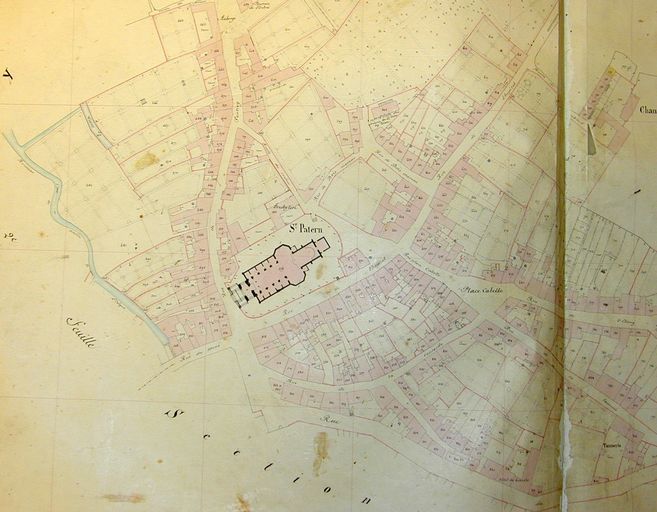
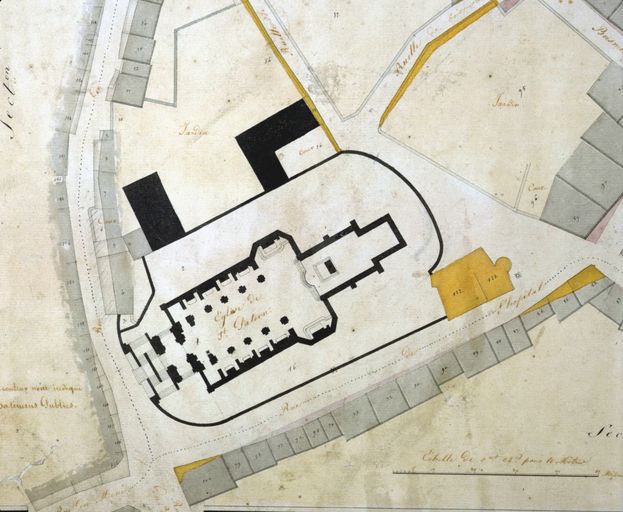

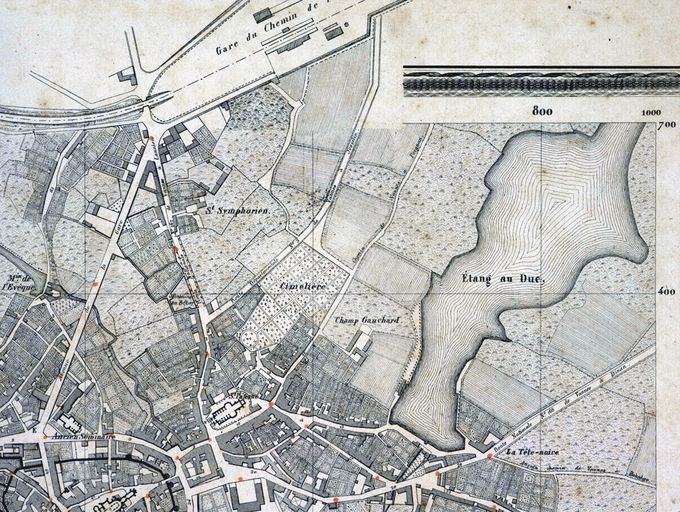


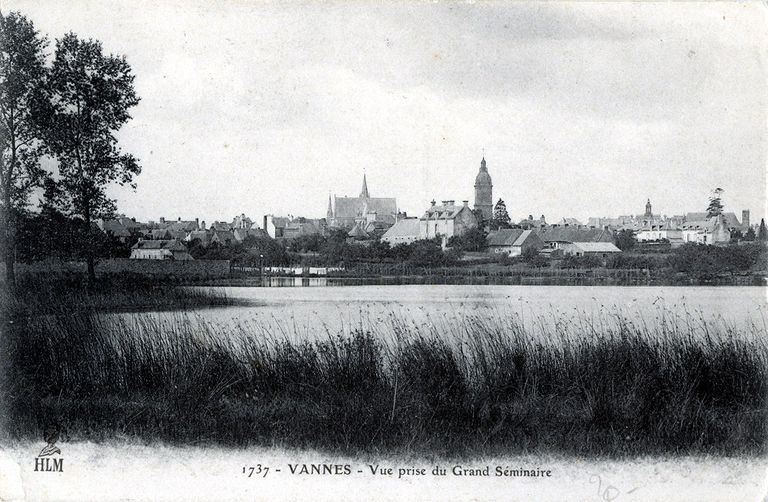

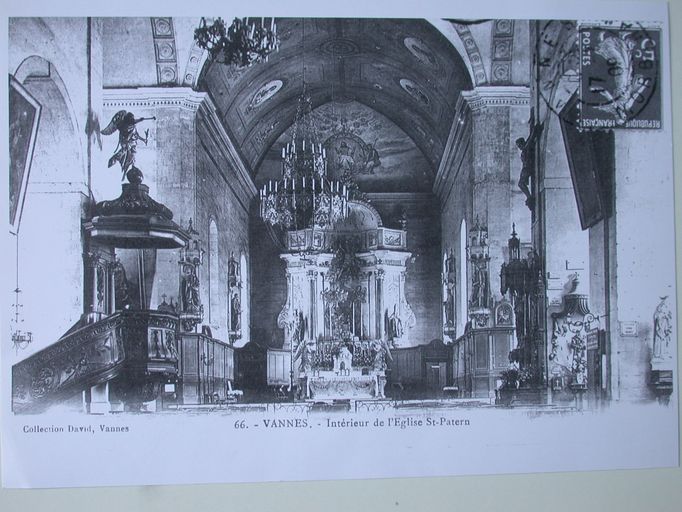
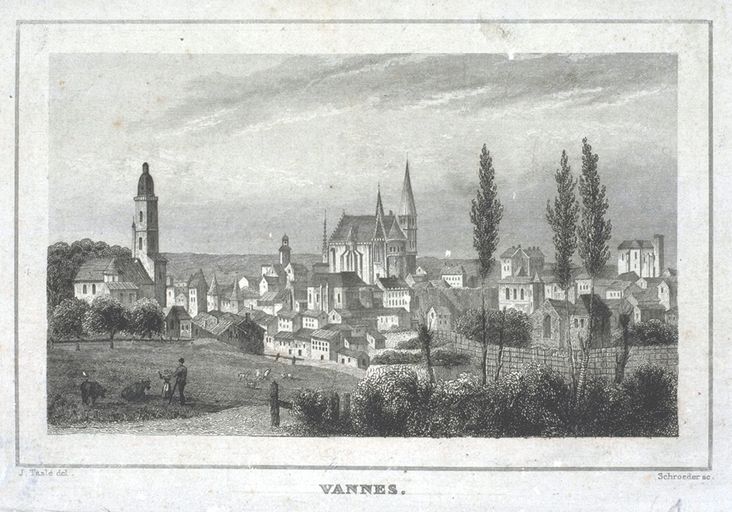











Architecte vannetais.
La terre et seigneurie de Boismourault et Bilaire sont vendues à Olivier Delourme pour la somme de 15000 £ par acte du 23 janvier 1722.