La chapelle actuelle est atypique de la construction religieuse locale par plusieurs de ses traits. Il s'agit d'une reconstruction : les baies remployées dans le bras nord datent d'un édifice antérieur qui remontait au moins au 15e siècle, sans qu'il soit possible d'en dire plus.
Le plan de l'édifice avec un seul bras en retour d'équerre au nord, est lié à une disposition topographique, l'espace dont on disposait étant plus important au nord de la chapelle qu'au sud. Ce bras nord, complètement lié au chœur pourrait être une chapelle seigneuriale, bien que sa taille très importante en fasse douter : le même blason (Lopriac ?) à demi buché figure sur les bénitiers du bras nord et de la nef ; l'arcade qui assure le lien entre les deux vaisseaux a été repris et abaissé au 17e siècle, sans doute lors de la reconstruction de l'aile nord.
C'est à cette même disposition topographique qu'on reliera l'importance donnée à l'élévation ouest, plus rare en Bretagne, où pour des raisons peut-être à l'origine climatiques, c'est la façade sud des édifices religieux qui est le plus souvent privilégiée. Les figures traitées en ronde-bosse au bas des rampants de l'élévation ouest, porte-blason, de même l'animal inséré dans le mur ouest ou les gargouilles concourent à l'animation de cette façade.
La nef complètement obscure, à l'exception de la baie axiale (puisque la baie sud du chœur est une création postérieure) est un trait relativement fréquent dans les édifices à vaisseau unique du 15e siècle : il ne faut pas cependant exclure la présence antérieure d'une fenêtre passante plus petite (dont le modèle apparaît précocement à Loicmaria de Ploemel), remplacée au 17e siècle par la fenêtre actuelle, agrandie en raison de l'obturation de la baie du chevet. La mise en oeuvre de la nef est d'une grande qualité, avec épaisse mouluration marquant le soubassement en épousant la pente sur la façade sud, par ailleurs peu visible, tandis qu'à l'intérieur, un banc court à la base des murs de pierre de taille.
La proximité d'Hennebont incite à voir l'empreinte ducale parmi les donateurs de la chapelle : peut-être est-ce leur blason qui était porté par les deux figures sculptées en ronde-bosse à l'ouest. Il faudrait cependant également éclairer le nom de la famille dont les armes figurent sur les bénitiers, peut-être les Lopriac qui portaient de sable au chef d'argent chargé de trois coquilles de gueules.





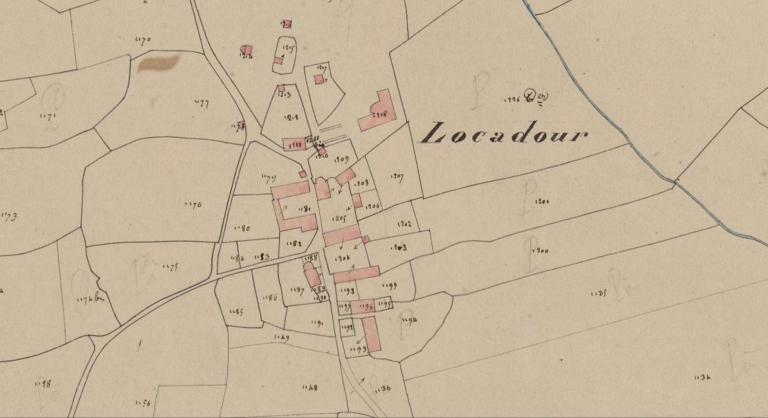
































Chargée d'études à l'Inventaire