Autres oeuvres conservées dans l´église :
NB : Les oeuvres sont décrites selon le plan adopté dans les notices individuelles :
Dénomination : matériau : technique ; dimensions. Etat de conservation. Inscriptions. Datation. Décor. Numéro d´image.
Une seule oeuvre d´une série ou d´une paire est généralement photographiée ; plusieurs oeuvres sont parfois rassemblées sur la même image ; elles sont décrites de gauche à droite dans les légendes.
Tabernacle : chêne : mouluré, tourné, décor dans la masse, verni, peint doré ; 73 h. Oeuvre déposée. 4e quart 19e siècle. Représentation : croix ; ornementation végétale. Fig. 5.
Ensemble de 7 Tabourets d´église : chêne : mouluré, tourné, ciré ; 44 h. Limite 19e siècle 20e siècle. Fig. 6.
Paire de Fauteuils : bois : mouluré, découpé, décor dans la masse, décor en bas-relief ; 85 h. 1ère moitié 20e siècle. Représentation : croix. Fig. 7.
Paire de Prie-Dieu : bois : mouluré, découpé, tourné, décor dans la masse, décor en bas-relief, verni ; soie (rouge) : velours uni, application sur textile ; 88 h. 4e quart 19e siècle. Représentation : croix. Fig. 8.
Ensemble de 4 Prie-Dieu : bois : mouluré, découpé, décor dans la masse, décor en bas-relief ; 77,5 h. 1er quart 20e siècle. Fig. 9.
Paire de Chandeliers d´acolyte : métal : fonte, gravé, doré ; 51 h. Oeuvre déposée. 4e quart 19e siècle. Représentation : ornementation végétale. Fig. 10.
Paire de Chandeliers d´église : métal : fonte, doré ; 58 h. Oeuvre déposée, les chandeliers ont été électrifiés. 1er quart 20e siècle. Représentation : blé ; vigne ; fleur de lys. Fig. 10.
Croix d´autel 1 : métal : fonte, argenté ; 71 h. Oeuvre déposée. 2e moitié 19e siècle. Représentation : Christ ; Vierge ; coeurs ; coeurs transpercés. Fig. 11.
Croix d´autel 2 : métal : fonte, doré ; 66,5 h. Oeuvre déposée. 2e moitié 19e siècle. Représentation : angelots ; triangle mystique ; coeur ; coeur enflammé. Fig. 11.
Croix d´autel 3 : métal : fonte, doré ; 65 h. Oeuvre déposée. 2e moitié 19e siècle. Représentation : croix ; ornementation végétale. Fig. 11.
Croix d´autel 4 : métal : fonte, doré ; 90 h. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : lancette ; fleur de lys ; quadrilobe. Fig. 12.
Paire de Croix d´autel : métal : fonte, argenté ; 66,5 h. Oeuvre déposée. 2e moitié 19e siècle. Représentation : angelots. Fig. 12.
Sonnette liturgique : métal : fonte, chromage ; 20 l. 1ère moitié 20e siècle. Fig. 13.
Lanterne du viatique : métal : fonte, découpé ; 30 h. Oeuvre déposée ; les verres sont cassés. 1er quart 20e siècle. Représentation : croix ; fleur de lys. Fig.13.
Plateau de communion : laiton : matrice, doré ; 25 l. 1ère moitié 20e siècle. Fig. 13.
Coquille de baptême : métal : fonte, gravé, argenté ; 9 l. Oeuvre déposée. 1er quart 20e siècle. Représentation : croix. Fig. 13.
Encensoir : métal : fonte, argenté ; 25 h. 19e siècle. Fig. 14.
Seau à eau bénite : métal : fonte, chromage ; 18,5 h. 19e siècle. Fig. 14.
Série de quatre Lanternes de procession : métal : fonte, doré ; 55 h. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Fig. 14.
Croix de procession 1 : métal : fonte, doré ; 109 h. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : Vierge à l´Enfant ; urne ; feuille de laurier. Fig. 15.
Croix de procession 2 : métal : fonte, argenté ; 83 h. Oeuvre déposée. 2e moitié 19e siècle. Représentation : urne ; feuille de laurier. Fig. 15.
Croix de procession 3 : métal : fonte, argenté, doré ; 79 h. Oeuvre déposée. 4e quart 19e siècle. Représentation : angelots ; vigne. Fig. 15.
Croix de procession 4 : métal : fonte, doré, peint, polychrome ; 52 h. Oeuvre déposée. 1e quart 20e siècle. Fig. 15.
Conopée 1 : soie (jaune) : drap d´or, application sur textile, adjonction d´éléments ; fil métal : argenté, doré. Oeuvre déposée. 1er quart 20e siècle. Représentation : agneau aux 7 sceaux ; rayon ; vigne ; ornementation végétale. Fig. 16.
Conopée 2 : soie (blanche) : tissu façonné, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; croix ; ornementation végétale. Fig. 16.
Tour d´autel : soie (blanche) : satin, brodé, polychrome, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée ; le tissu est coupé par l´usure. 1er quart 20e siècle. Représentation : ornementation végétale. Fig. 17.
Paire de Pavillons de ciboire : soie (blanche) : satin, brodé, application sur textile, adjonction d´éléments ; fil métal : doré. Oeuvre déposé. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; blé ; ornementation végétale. Fig. 18.
Aubes : lin (blanc) : toile, dentelle, brodé. Oeuvre déposée. 1ère moitié 20e siècle. Pas de fig.
Ornement blanc 1 : Chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (blanche) : gros de Tours, moiré, application sur textile, brodé, polychrome ; fil métal : doré. Oeuvre déposée ; les broderies sont usées sur le devant de la chasuble. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : IHS ; ornementation végétale. Fig. 19.
Ornement blanc 2 : Chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (blanche) : gros de Tours, application sur textile. Oeuvre déposée. Milieu 20e siècle. Représentation : AM ; banderole ; ornementation stylisée. Fig. 19.
Ornement blanc 3 : Chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (blanche) : tissu façonné, application sur textile, tapisserie au point, polychrome. Oeuvre déposée. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; fleuron. Fig. 20.
Ornement blanc 4 : Chasuble, bourse de corporal, manipule, voile de calice : soie (blanche) : tissu façonné, brodé, polychrome. Oeuvre déposée ; il manque l´étole. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; quadrilobe ; fleuron. Fig. 20.
Ornement doré 1 : Chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (jaune) : drap d´or, application sur textile, adjonction d´éléments ; fil métal : argenté, doré. Oeuvre déposée. 1er quart 20e siècle. Représentation : agneau aux 7 sceaux ; rayon ; rinceau fleuri. Fig. 21.
Ornement doré 2 : Chasuble : soie (jaune) : drap d´or, application sur textile, adjonction d´éléments ; fil métal : argenté, doré ; verre transparent (rouge, vert, violet, blanc) : taillé à facettes. Oeuvre déposée ; il manque la bourse de corporal, l´étole, le manipule et le voile de calice. 4e quart 19e siècle. Représentation : agneau aux 7 sceaux ; rayon ; rinceau fleuri. Fig. 21.
Ornement noir 1 : Chasuble, bourse de corporal, manipule, voile de calice : soie (noire) : tissu façonné, application sur textile. Oeuvre déposée ; il manque l´étole. Milieu 20e siècle. Représentation : croix ; ornementation stylisée. Fig. 22.
Ornement noir 2 : Chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (noire) : tissu façonné, application sur textile. Oeuvre déposée. Milieu 20e siècle. Représentation : chrisme ; alpha ; oméga ; ornementation stylisée. Fig. 22.
Ornement noir 3 : Chasuble, bourse de corporal, étole, voile de calice : soie (noire) : velours uni, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée ; il manque le manipule. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : IHS ; couronne d´épines ; rayons ; croix ; clous. Fig. 23.
Ornement noir 4 : Chasuble, bourse de corporal, manipule, étole, voile de calice : soie (noire) : velours uni, application sur textile ; fil métal : argenté. Oeuvre déposée. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; cercle ; fleuron ; ornementation stylisée. Fig. 23.
Ornement noir 5 : Chasuble, bourse de corporal, manipule, étole, voile de calice : soie (noire) : velours uni, application sur textile ; fil métal : argenté. Oeuvre déposée. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; rayon ; rinceau fleuri. Fig. 24.
Ornement rouge 1 : Chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (rouge) : satin, application sur textile, tapisserie au point, polychrome. Oeuvre déposée ; le tissu est usé devant. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; quadrilobe ; ornementation stylisée. Fig. 24.
Ornement rouge 2 : Chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (rouge) : satin, application sur textile ; soie (verte) : sergé, application sur textile. Oeuvre déposée ; le tissu est usé devant. Milieu 20e siècle. Fig. 25.
Ornement rouge 3 : Chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (rouge) : satin, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; rayon ; ornementation végétale Fig. 25.
Ornement vert 2 : Chasuble, bourse de corporal, manipule : soie (verte) : tissu façonné, application sur textile. Oeuvre déposée ; il manque le voile de calice. Milieu 20e siècle. Représentation : IHS ; croix ; ornementation stylisée. Fig. 26.
Ornement vert 3 : Chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (verte) : tissu façonné, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. Milieu 20e siècle. Représentation : chrisme ; alpha ; oméga ; ornementation stylisée. Fig. 26.
Ornement violet 2 : Chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (violette) : tissu façonné, brodé, polychrome, application sur textile. Oeuvre déposée ; les galons sont usés. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; ornementation végétale. Fig. 27.
Ornement violet 3 : Chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (violette) : tissu façonné, polychrome, application sur textile. Oeuvre déposée ; le tissu du devant de la chasuble a été remplacé. 1ère moitié 20e siècle. Représentation : croix. Fig. 27.
Ornement violet 4 : Chasuble, bourse de corporal, manipule, voile de calice : soie (violette) : tissu façonné, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée ; le tissu du devant de la chasuble a été remplacé ; il manque l´étole. Milieu 20e siècle. Représentation : chrisme ; croix ; cercle ; alpha ; oméga. Fig. 28.
Ornement rouge 4 : Chasuble, bourse de corporal : soie (rouge) : tissu façonné, application sur textile, adjonction d´éléments ; fil métal : doré, argenté. Oeuvre déposée ; il manque l´étole, le manipule, le voile de calice. 4e quart 19e siècle. Représentation : agneau aux 7 sceaux ; rayon. Fig. 28.
Étole pastorale 1 : soie (noire) : velours uni, brodé, application sur textile ; fil métal : argenté. Oeuvre déposée ; il manque les glands de passementerie. 1er quart 20e siècle. Représentation : croix ; rinceau fleuri. Fig. 29.
Étole pastorale 2 : soie (noire) : velours uni, application sur textile ; fil métal : argenté. Oeuvre déposée. 4e quart 19e siècle. Représentation : chrisme ; alpha ; oméga ; rinceau fleuri. Fig. 29.
Étole pastorale 3 : soie (noire) : velours uni, application sur textile, adjonction d´éléments ; fil métal : argenté. Oeuvre déposée ; la cannetille est abîmée. 1er quart 20e siècle. Représentation : croi ; rayon. Fig. 29.
Étole pastorale 4 : soie (noire) : velours uni, application sur textile ; fil métal : argenté. Oeuvre déposée. 4e quart 19e siècle. Représentation : croix ; rinceau fleuri. Fig. 29.
Étole pastorale 5 : soie (jaune) : drap d´or, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. Milieu 20e siècle. Représentation : blé ; croix. Fig. 30.
Étole pastorale réversible : soie (rouge, verte) : velours uni, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. Milieu 20e siècle. Représentation : croix ; ornementation stylisée. Fig. 30.
Voile huméral 2 : soie (jaune) : drap d´or, application sur textile, adjonction d´éléments ; fil métal : argenté, doré. Oeuvre déposée. 1er quart 20e siècle. Représentation : coeurs transpercés ; couronne d´épines ; rayons. Fig. 31.
Voile huméral 3 : soie (blanche) : tissu façonné, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; fleurs de lys. Fig. 31.





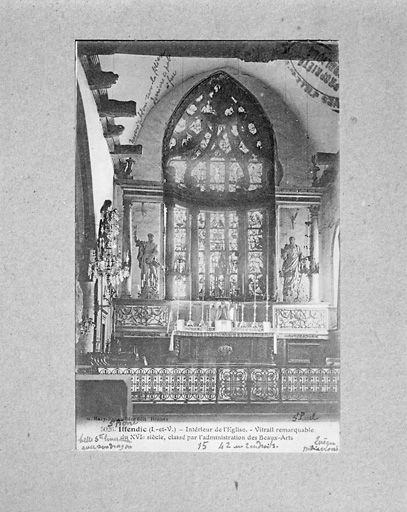


































Photographe à l'Inventaire