Roger Henrard (10 février 1900-26 juin 1975) a été pilote de tourisme après la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu le directeur des établissements Jules Richard situés à Paris (21 rue Carducci dans le 19e arrondissement) qui fabriquaient des appareils enregistreurs pour la météo et des appareils photographiques stéréoscopiques.
La société d'exploitation de la photographie aérienne Roger Henrard lui a succédé (ses bureaux étaient situés à Saint Maur-des-Fossés dans le département du Val-de-Marne et ses laboratoires à Le Ban-Saint-Martin en Moselle). Elle commercialisait les photographies aériennes réalisées par Roger Henrard à l'aide d'un "Altiphote" Richard-Labrély installé à bord de son avion.
Après la mort du pilote, la société, par l'intermédiaire de sa gérante, Madame Genetel, a revendu une partie des clichés (négatifs et épreuves) à de nombreux services d'archives de communes et de départements que Roger Henrard avait survolés.
Achetée en 1979 à la société d'exploitation de la photographie aérienne "Roger Henrard" de Saint-Maur, la collection Roger Henrard se constitue d'un ensemble de 464 clichés photographiques (noir et blanc et couleur). Elle représente des vues prises entre 1948 et 1972 pour un ensemble de 68 communes du département des Côtes-d'Armor (de Belle-Isle-en-Terre à Yffiniac). L'intérêt de ces photographies réside dans le fait que la vue aérienne n'est pas verticale mais oblique et qu'elle ne cherche pas à embrasser un trop grand secteur mais seulement des quartiers ou des sites particuliers : des cartes postales modernes en quelques sorte et qui sont infiniment précises pour l'histoire de l'habitat et l'étude du paysage.
La classement et la description des 464 clichés photographiques a permis la rédaction d'un répertoire numérique (26 Fi). Les clichés photographiques sont classés selon l'ordre alphabétique des 68 communes représentées. Chaque tirage photographique est doté d'un numéro d'épreuve et d'une cote précise (de 26 Fi 1 à 26 Fi 464).
(Texte de présentation de la collection photographique Roger Henrard par les Archives départementales des Côtes-d'Armor).





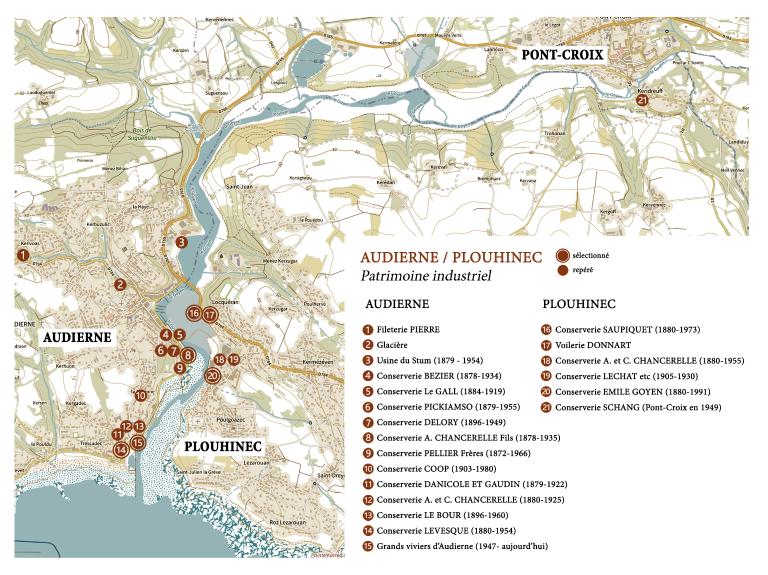
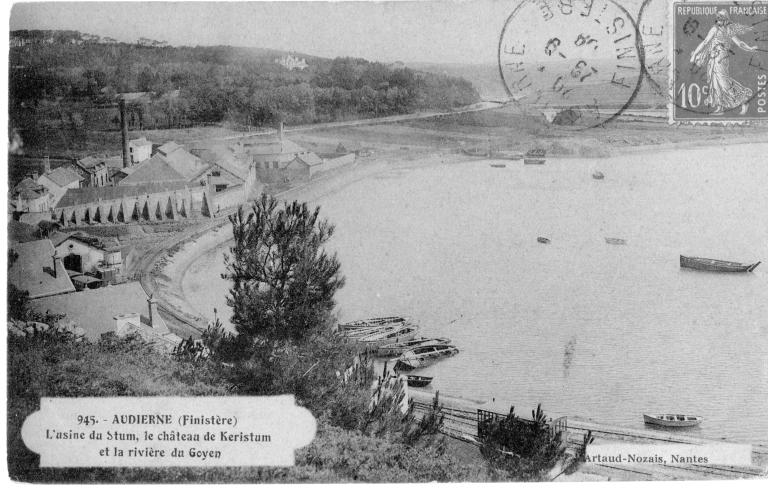
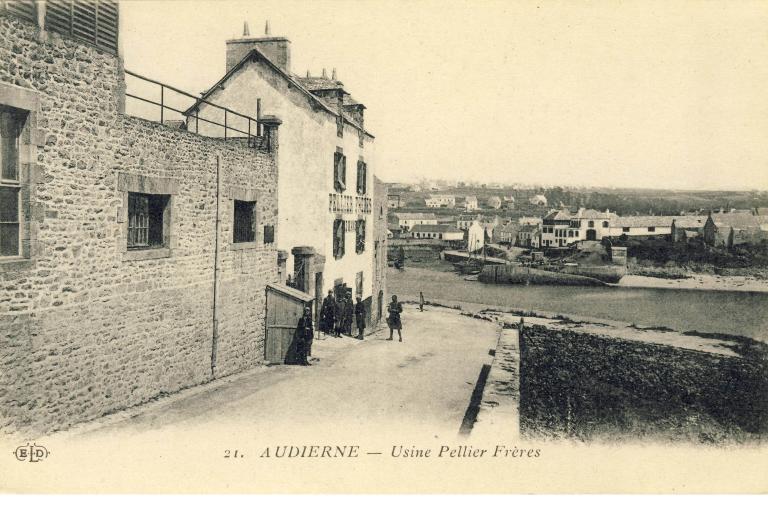
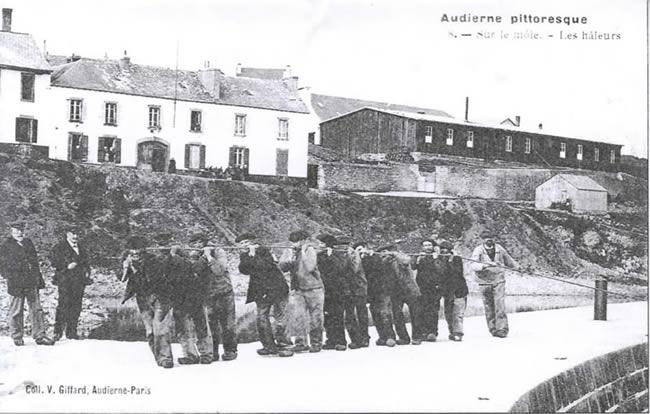






Chargée d'études à l'Inventaire