Photographe à l'Inventaire
- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne
Dossier non géolocalisé
-
Aire d'étude et canton
Bretagne Nord
-
Commune
Roscanvel
-
Lieu-dit
Route de Quélern
-
Adresse
-
Cadastre
AK
113
-
Dénominationscaserne
-
AppellationsCaserne Vauban
-
Destinationscaserne
-
Période(s)
- Principale : 19e siècle
- Principale : 20e siècle
-
Dates
- 1793, daté par source
- 1826, daté par travaux historiques
-
Murs
- maçonnerie
-
Toitsardoise
-
Plansplan rectangulaire régulier
-
Étagesrez-de-chaussée, 2 étages carrés, 2 étages de comble
-
Couvertures
- toit à deux pans
-
État de conservationrestauré
-
Statut de la propriétépropriété de l'Etat
-
Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, à signaler
Il s'agit d'un site en terrain militaire : l'accès est interdit sans autorisation préalable.
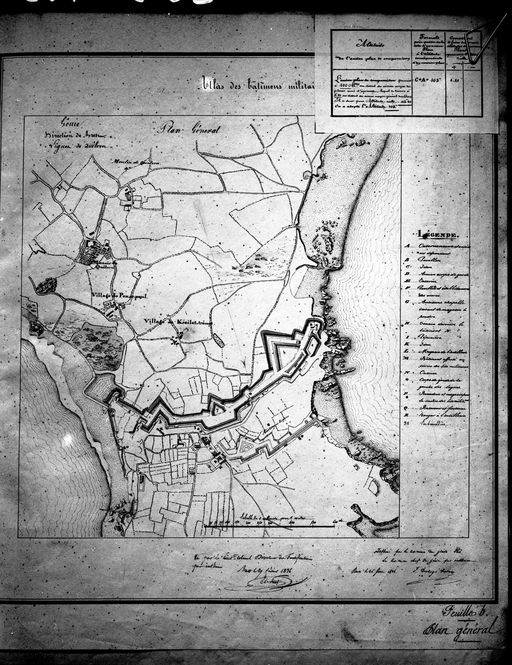
- (c) Inventaire général, ADAGP
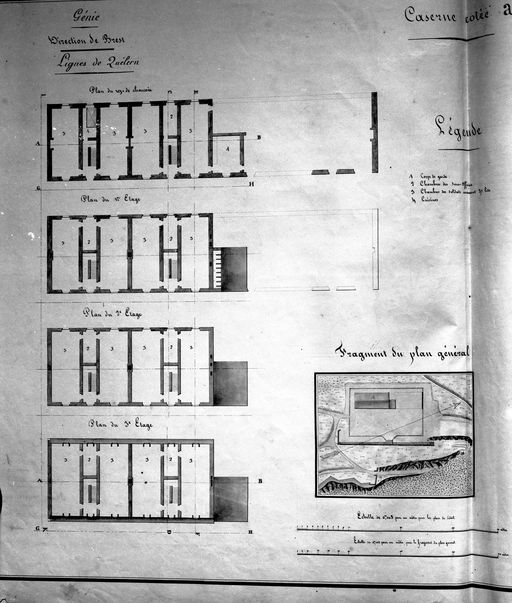
- (c) Inventaire général, ADAGP
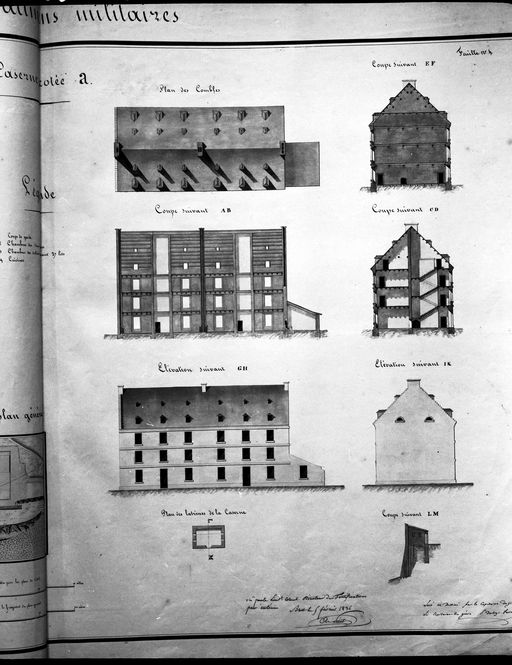
- (c) Inventaire général, ADAGP
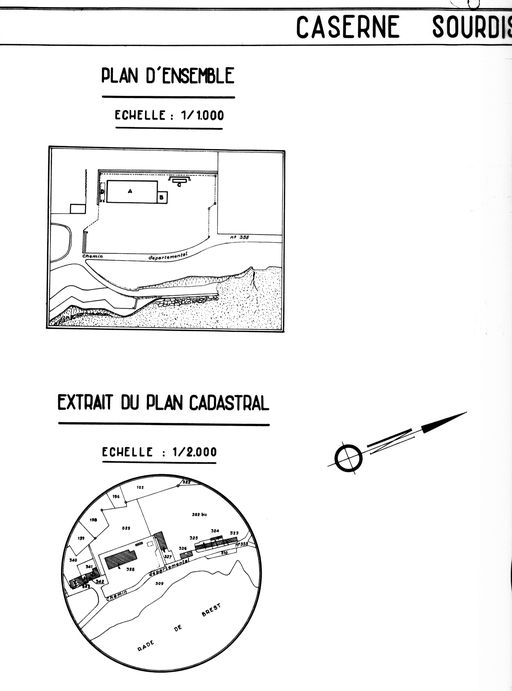
- (c) Inventaire général, ADAGP
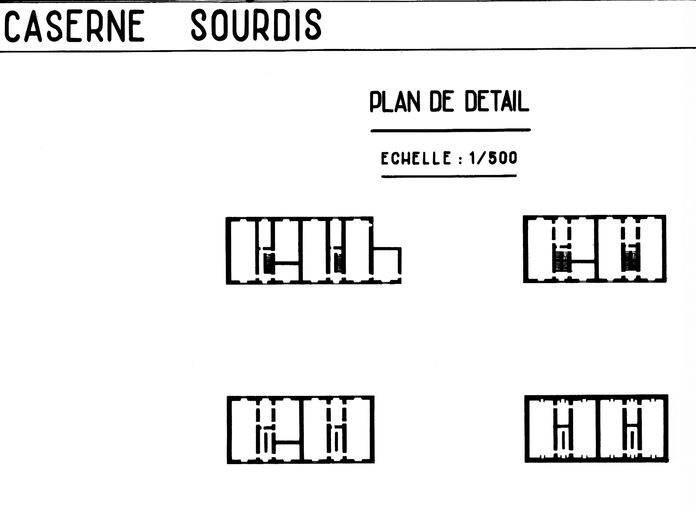
- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP
Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.
Fait partie de

Anciens casernements actuellement Centre de vacances de l'Institution de Gestion Sociale des Armées (I.G.E.S.A.), Lagatjar, Pointe de Kerbonn (Camaret-sur-Mer)
Lieu-dit : Pointe de Kerbonn
Adresse : Lagatjar

Retranchements (4e quart 17e siècle) puis fortifications extra-urbaines (4e quart 18e siècle) de Quélern (Cr 36-39) (Roscanvel)
Lieu-dit : Quélern
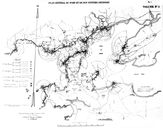





Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.